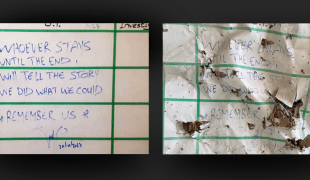Crise du financement du Fonds mondial : la France doit être à la hauteur de ses engagements
Communiqué de presse

À l’approche du sommet du Fonds mondial à Johannesburg, Médecins sans Frontières (MSF) appelle les principaux États donateurs, notamment la France, à financer intégralement les 18 milliards de dollars nécessaires à la lutte contre le VIH, la tuberculose et le paludisme. Si cet objectif n’est pas atteint, des coupes drastiques vont avoir lieu et pourraient favoriser la résurgence de ces maladies, tout en faisant peser le coût des soins sur les patients les plus vulnérables.
Le 21 novembre, en marge du G20, une réunion de haut niveau coorganisée par le Royaume-Uni et l’Afrique du Sud visera à mobiliser des fonds pour le cycle 2027-2029. Mais le Fonds mondial pourrait recevoir des promesses de dons bien inférieures à l’objectif nécessaire pour combattre efficacement le VIH, la tuberculose et le paludisme — voire en deçà des 15 milliards du dernier réapprovisionnement, déjà largement insuffisant.
Il est essentiel que la France, membre fondateur et deuxième État contributeur au Fonds mondial derrière les États-Unis en 2022, ayant alors joué un rôle moteur dans la mobilisation des autres États donateurs pour atteindre des objectifs ambitieux, poursuive ses efforts et maintienne son financement au moins au même niveau que lors du cycle précédent. Sa contribution doit être à la hauteur de ses objectifs affichés en matière de santé mondiale.
« Lorsque les financements sont insuffisants, ce sont les patients qui n’ont pas les moyens de se soigner qui en paient le prix », déclare Tess Hewett, conseillère en matière de politique de santé pour MSF.
Ne pas atteindre l’objectif de 18 milliards de dollars aurait des conséquences immédiates, notamment des coupes dans des activités essentielles telles que les systèmes de collecte de données pour la surveillance des maladies ou la fourniture de soins. Cela entraînerait un recul dans les progrès acquis jusqu’alors, ainsi qu’un affaiblissement majeur de la lutte contre la tuberculose, dont 76% des financements proviennent du Fonds mondial. Cela limiterait aussi l’accès à des outils innovants, tels que les nouveaux vaccins contre la tuberculose, le paludisme ou les traitements préventifs du VIH comme le lénacapavir.
Par ailleurs, des engagements tardifs de financement au-delà du 21 novembre compromettront la planification des programmes et imposeront le recours à des solutions moins efficaces d’optimisation des portefeuilles ou de financements en milieu de cycle.
Les engagements financiers actuels sont très préoccupants : les deux seuls pays à s’être engagés jusqu’à présent ont réduit leur contribution, passant de 1,3 milliard d’euros à 1 milliard pour l'Allemagne, et de 1,1 milliard d’euros à 960 millions d’euros pour le Royaume-Uni.
Si les principaux donateurs, et notamment la France, suivent l'exemple de l'Allemagne et du Royaume-Uni, les conséquences seront catastrophiques pour les personnes touchées par la tuberculose, le VIH et le paludisme dans le monde entier, les trois maladies infectieuses les plus mortelles au monde.
« Pour endiguer le VIH, la tuberculose et le paludisme comme menaces sanitaires, le Fonds mondial doit obtenir les 18 milliards requis. Avec ces ressources, il estime pouvoir sauver 23 millions de vies et réduire de moitié les décès en six ans. La France a aujourd’hui l’opportunité de démontrer son rôle de leader dans le domaine de la santé mondiale en maintenant ou augmentant sa contribution », plaide Tess Hewett.